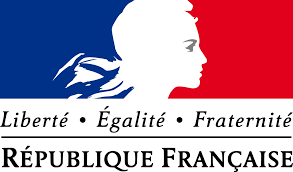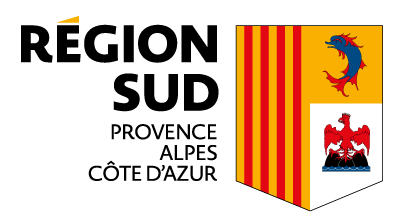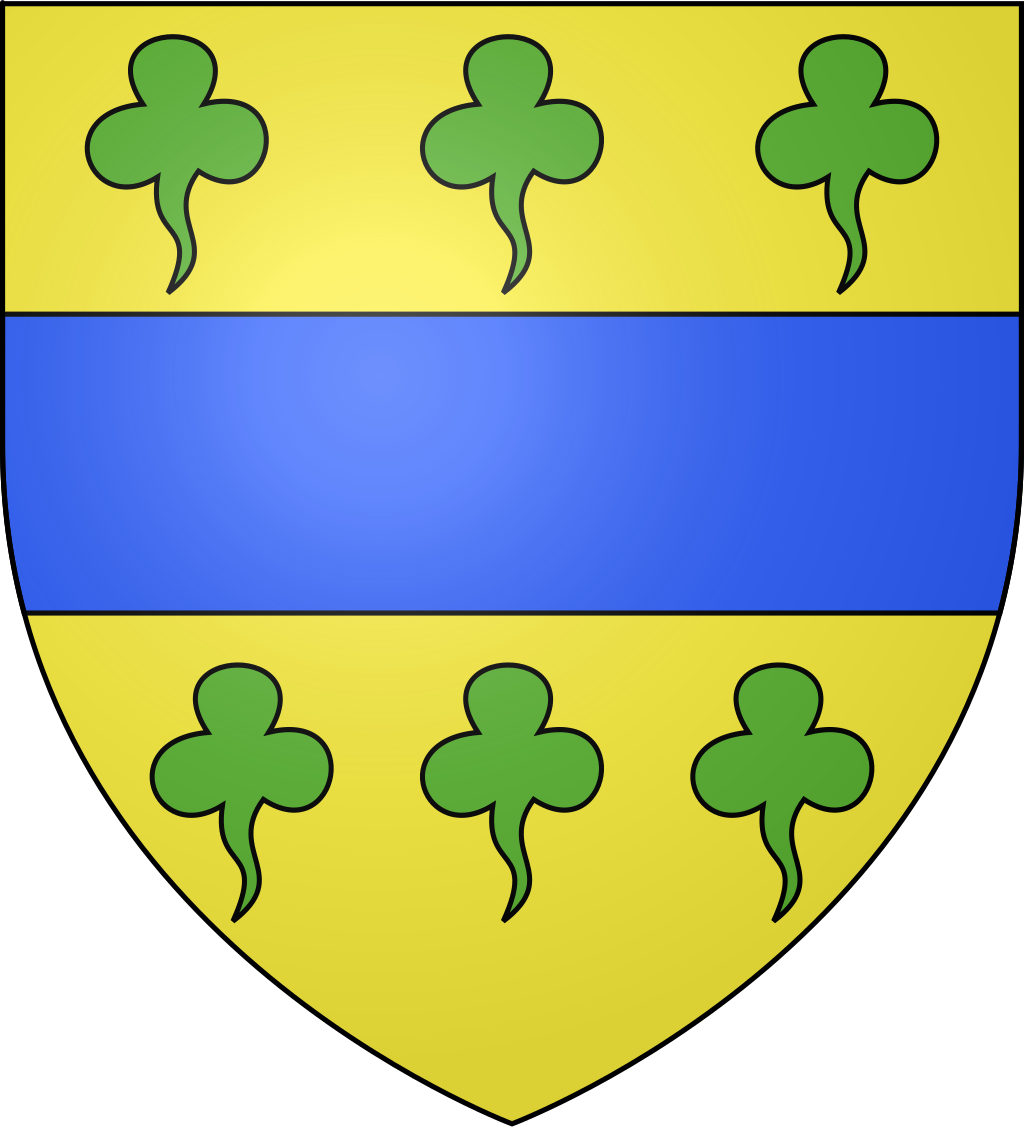Mémoire de la vallée
Gloires du moyen-âge

Des mentions latines témoignent des activités de la vallée au XIIIe siècle et les templiers auraient dit-on investi les domaines de la Haute-Bléone mais si les contours de ces récits restent flous l’Abbaye de Faillefeu demeure le plus riche témoin de ce passé médiéval.
Crée au XIIe siècle par les moines de l’abbaye de Boscodon, soumis à l’ordre bénédictins de Citeaux, l’abbaye de Notre Dame ou de « Sainte-Marie de Villevieille » est plus communément baptisée abbaye de Faillefeu du nom de la forêt locale. Judicieusement implantée près du col de Chaluffy, véritable axe de communication, son histoire évoque une époque glorieuse. Au XIVe siècle elle passa sous les ordres de Saint-Martial à Avignon. Elle fut saccagée pendant les guerres de religion et les ultimes vestiges périrent dans un incendie accidentel au siècle dernier. Cette période romane a laissé d’autres très beaux vestiges de l’architecture religieuse comme en témoigne l’église de Vière qui a fait l’objet d’une très belle restauration contemporaine et dont la cuve baptismale est exposée sur la place du village de Prads.
Les grandes mutations des XIXe et XXe siècles
Au cours du XIXe siècle face aux épidémies et aux famines les campagnes se vident au profit de rêves urbains. La vallée de la Haute-Bléone n’est pas épargnée par le déplacement des populations qui bouleverse le monde rural. En 1836 le territoire de la commune actuelle recensait près de 1300 habitants, à la veille du 1er conflit mondial on n’en comptait pas moins de la moitié !
Les grandes guerres du XXe siècle et la course vers la modernité finiront d’affaiblir les communautés rurales.
Certains hameaux sont désertés ou peu à peu s’éteignent.
L’Immerée n’est plus habité depuis 1914, l’Adrech depuis 1928, Piéfourcha 1934.
Le site des Eaux Chaudes est détruit par les allemands en 1943 et les maisons sont peu à peu abandonnées à Heyres… Les dernières écoles résistent jusqu’au dernier quart du siècle passé, des métiers disparaissent.
Des lieux ainsi sont convertis au silence mais l’habitat se resserre et la vie continue…
Aujourd’hui la commune de Prads-Haute Bléone se ré-invente, néo-ruraux, touristes et natifs de la vallée construisent un nouvel équilibre.


La Haute-Bléone, au cœur de la résistance
Dans le contexte de l’été 1944, les diverses organisations attendent un débarquement similaire à la Normandie en Provence, les résistants se mobilisent, les attaques des convois allemands se multiplient et la répression s’intensifie. Le Poste de Commandement de Sapin, chef départemental de l’Organisation de la Résistance de l’Armée se replie au hameau des Eaux Chaudes le 20 juillet, la ferme du Serre abrite alors depuis deux jours l’infirmerie du Dr Fang.
Les allemands sont à Seyne le 29 juillet. Le 30, bien renseignés, 7 camions attaquent les deux sites de la Haute-Bléone, certains résistants parviennent à s’échapper des Eaux Chaudes avant que le site ne soit incendié mais 6 maquisards seront fusillés au Serre.
De nombreux résistants élurent refuge dans la vallée, on les retrouve au gré des récits disséminés dans les cabanons de La Colle, à Gaudichart, à Chavailles ou encore dans l’ancienne mairie de Vière. On les retrouve aussi dans la voix des anciens, gardiens vivants de notre histoire…
LES RICHES HEURES DE LA BLEONE
La cueillette et la distillation de la lavande connaissent un essor au XXe siècle dans l’ensemble des basses Alpes.
Au sein de la vallée très vite, les sites de Rancure, Gaudichart, Coulicourt, Richardeau sont reconnus pour leurs plants sauvages. Presque tous les hameaux alimentent alors leurs alambics, Blégiers distille jusqu’à 400 kg ! L’exploitation de la lavande devient pendant un temps une source importante de revenus et l’intensité de l’activité nécessite une réglementation rigoureuse, droits versés à la commune, permis d’exploitation, dates de récolte…
« Les champs étaient d’un bleu azur et la vallée embaumait du mois d’août jusqu’au mois d’octobre » tel est le parfum de nostalgie qui teinte encore les images du siècle passé.
Des ressources hydro-électriques
En juillet 1899 la mairie de Prads s’accorde avec un entrepreneur de Digne et convient de l’utilisation des eaux de la source qui coule en face de Tercier et de celles du Riou de l’Aulne pour le transport de l’énergie électrique. Un mois plus tard ce même industriel signe un contrat d’exploitation pour les eaux qui coulent au dessus de Chanolles avec la commune de Blégiers.
Ainsi nait avec le siècle précédent le début d’une activité qui aura son importance. En 1903, une partie de l’éclairage de la ville de Digne-les-bains provient de l’énergie fournie par la Bléone et ses affluents.


Nos partenaires